6-3 Techniques vol à voile (motoplaneurs)
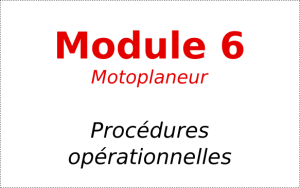
| Module 6 - Pocédures Opérationnelles. Cliquer pour naviguer dans les sous-pages du module : |
|---|
|
Techniques utilisées en vol à voile (facultatif)
© Copyright article original par les auteur(s) de Wikipédia, adapté - Cet article est sous CC BY-SA 3.0
- Ascendances
- thermiques
- dynamiques
- vol d'onde
- vol en circuit
Faire du vol à voile consiste à trouver des masses d'air dont les vitesses d'ascension sont plus élevées que la vitesse de chute propre du planeur et ainsi gagner de la hauteur. Les masses d'air ascendantes, ou ascendances étant généralement très localisées, les pilotes doivent s'arranger pour rester à l'intérieur. Les pilotes parlent souvent de « faire le plein », l'objectif étant de gagner le maximum d'altitude offerte par les conditions météo du jour. Cette expression illustre aussi le fait que l'énergie potentielle du planeur —ou son altitude, ce qui revient au même— peut être considérée comme son carburant.
Les masses d'air ascendantes les plus connues sont :
- les ascendance thermique qui sont le résultat du soleil qui chauffe le sol,
- les ascendances dues à l'effet de pente lorsque le vent frappe un relief le forçant à passer par-dessus,
- les ascendances d'une onde, créées par un reliefs et des conditions de vents particulières. Ils permettent d'atteindre des altitudes très importantes.
Le Vol thermique
Article détaillée Ascendance thermique de Wikipédia.
En vol de thermique, le pilote recherche des colonnes d'air ascendantes qui résultent de l'échauffement du sol par le soleil. L'air en contact avec le sol est alors réchauffé et peut se mettre à monter spontanément comme une montgolfière.
Les bulles d'air chaud les plus probables se trouvent dans les zones de contrastes thermiques telles que les champs moissonnés, des parkings de supermarché, les routes et autoroutes, et surtout les gravières et secteurs rocheux. Si l'on est certain de ce principe physique, il reste difficile d'associer un aspect du sol avec la certitude de la présence d'une ascendance thermique. C'est pour ce côté aléatoire que le pilote doit conserver une zone posable accessible suivant son altitude, à tout instant .
Le vol de thermique nécessite une colonne régulière d'air chaud, exploitable lorsque le profil de température de la masse d'air est bon, et le soleil suffisamment puissant. En règle générale, cela se produit à nos latitudes moyennes du printemps à la fin de l'été. Il y a peu de thermiques en hiver, compte tenu du faible ensoleillement et des masses d'air qui possèdent des caractéristiques de gradient de température qui limite le phénomène de la convection.
Dans certaines conditions d'humidités et de température, une ascendance thermique forme un nuage. Ces nuages de forme cotonneuse et à base plate, formés par des ascendances sont appelés Cumulus, avec une déclinaison suivant leur taille : Cumulus Fractus, Cumulus Humilis, Cumulus médiocris, Cumulus Congestus, Cumulo Nimbus. Lorsque les conditions d'humidités et de températures ne sont pas réunis, les ascendances ne forment aucun cumulus ce qui rend plus difficile la détection des ascendances, on parle de thermiques purs.
Lorsque le pilote vélivole trouve un thermique, aidé généralement par sa matérialisation en cumulus, il se met à décrire des spirales pour rester dans l'étroite zone qui monte. Il tentera en permanence de re-centrer l'ascendance pour trouver la meilleure zone de montée en décalant son virage, augmentant l'inclinaison. Avant de se trop se rapprocher de la base du cumulus (par exemple 300m pour des raisons légales dans certains cas, ou environ 50m pour des raison de visibilité), ou bien arrivé au sommet du thermique pur à proximité de la couche d'inversion, le pilote quitte la zone et utilise l'altitude gagnée pour planer vers son prochain objectif.
L'ascendance se poursuit dans le nuage et même se renforce, la condensation de l'eau libère de la chaleur (chaleur latente de condensation).
Quelques astuces de pilotes :
- de fortes ascendances thermiques implique normalement la présence de fortes descendances dans la zone.
- les ascendances sont inclinées par le vent. Sous un gros cumulus, on trouveras les ascendances "au vent" et "coté soleil"
- Les ascendances peuvent s'aligner avec un vent fort (les descendances aussi). Les cumuls qui les chapeautes sont donc alignées, appelés "rue de cumulus"
- un planeur qui s'approche trop près d'un cumulus peut être contraint de sortir ses aérofreins pour arrêter de monté le temps de quitter la zone.
La mécanique de l'ascendance thermique
- Le mouvement de la bulle d'air se fait sans échange de chaleur avec l'air environnant car les masses d'air se mélangent mal.
- La pression diminue lorsque l'altitude augmente, la bulle qui monte se dilate (ou se détend). Comme l'énergie thermique de la bulle d'air chaud reste constante (pas d'échange de chaleur avec l'air environnant), on parle de détente adiabatique. La baisse de température est uniquement due à la détente, on parle alors de gradient thermique adiabatique qui dépend des conditions qui règnent sur terre. Sa valeur approximative est de 1°C/100m en atmosphère sec (hors nuage), et de 0.5 à 0.8°C/100m en atmosphère saturé (dans les nuages).
En théorie, il existe 3 comportements possibles, qui dépendent du profil vertical de la température de l'air ambiant :
- Situation Stable : Si le gradient de température est plus faible que 1°C/100m, alors une bulle d'air poussée vers le haut devient plus froide que l'air qui l'entoure du fait de sa dilatation adiabatique. La bulle a tendance à redescendre à sa position initiale. La masse d'air est dite stable. Ce type de masse d'air n'est pas favorables à la convection.
- Situation Instable : Si la diminution de température de l'air ambiant avec l'altitude est plus élevé que 1°C/100m, alors une bulle d'air poussée vers le haut restera toujours plus chaude (donc plus légère) que l'air qui l'entoure du fait de la dilatation adiabatique, et a donc tendance accélérer vers le haut. La masse d'air est dite super-adiabatique ou instable. Dans le cas d'une masse d'air instable, il n'est même pas nécessaire que le soleil réchauffe le sol, car tout mouvement résulterait en une accélération de ce mouvement. Dans les faits une telle situation d'équilibre instable ne perdure pas. Les mélanges verticaux vont spontanément se réaliser, plus ou moins brutalement (Orages dans les cas les plus brutaux), et le gradient de température vertical va se stabiliser à environ 1°/100m. Ce type de masse d'air est en quelque sorte trop favorable à la convection.
- Si le gradient de température est égale au gradient thermique adiabatique de 1°/100m, La situation est ni stable, ni instable. C'est une situation favorable à une convection générée par l'échauffement du sol par le soleil.
Ces trois situations peuvent survenir en atmosphère saturé d'humidité, la valeur du gradient est alors de 0.5 à 0.8°C/100m.
L'atmosphère réelle est une situation où des couches de ces trois situations peuvent se superposé. Par exemple :
- Une couche ni stable ni instable seche, surmonté d'une couche stable à 1800m : favorable au vol à voile.
- une couche stable entre 300 et 800m : défavorable au vol à voile (trop bas)
- une couche ni stable ni instable en dessous de 3000m, surmonté d'une couche instable de 3000m à 8000m défavorable au vol à voile (orage).
- typique en Europe du Nord d'une situation pré-orageuse. Couche stable entre 1500 et 2500m, la température augmente grâce au soleil à basse altitude par un phénomène de bouchon. Ensuite, des orages violents éclatent lorsque le bouchon cède.
Vol de pente
le gain d'altitude dépasse rarement quelques centaines de mètres au-dessus du sommet des reliefs ; ces ascendances sont appelées ascendances dynamiques ;
Modèle:Article détaillé En situation de vol de pente, en revanche, le pilote recherche les masses d'air ascendantes qui résultent d'un mouvement mécanique dû à l'action du vent sur le relief. Le vol de pente fonctionne sous tous les climats et par tous temps mais uniquement en certains lieux dès lors que l'intensité du vent est suffisante (~ Modèle:Unité). Ces reliefs doivent être suffisamment étendus afin d'éviter d'être contournés par le vent. Les ascendances ainsi générées peuvent généralement se prolonger jusqu'à 500 à Modèle:Unité au-dessus de la ligne de crête suivant la forme de la pente et la force du vent. Lors de journées ensoleillées, les pentes exposées au soleil se réchauffent plus vite que les zones environnantes et il se produit alors un phénomène de vent anabatique qui peut s'ajouter au vent ambiant. Ce dernier phénomène est appelé par les vélivoles français « ascendance thermo-dynamique » ; il est l'addition d'un phénomène thermique et dynamique. Aux États-Unis, on parle simplement de vent anabatique. Les pentes exposées au soleil sont ainsi de bons déclencheurs de thermiques.
Le record de durée en planeur monoplace revient à Charles Atger réalisé le Modèle:Date sur planeur Air 100, d'une durée de 56 heures et 15 minutes, au départ de l'aérodrome du Mazet de Romanin<ref>Soaring, mai-juin 1955, p. 24</ref>Modèle:,.
L'aérologie particulière de ce terrain de vol à voile, liée à l'intensité et la durée du vent de mistral a permis la réalisation de ce record. Des éclairages furent installés afin d'éclairer la chaîne des Alpilles durant ce vol de durée.
Pour des raisons de sécurité, le code sportif ne reconnaît plus de record de durée depuis l'accident mortel de Bertrand Dauvin en 1954<ref>Modèle:Ouvrage</ref>.
Vol d'onde
Modèle:Article détaillé Le vol d'onde est une variante de vol orographique permettant au planeur de monter beaucoup plus haut que le vol de pente.
En effet, sous le vent du relief, et sous certaines conditions, se produisent un ou plusieurs ressauts, du fait de l'élasticité de l'air[Faux]. Ces ondes peuvent atteindre de grandes altitudes, largement supérieures à celle du relief générateur. Ces zones de ressauts sont parfois matérialisées par des nuages particuliers appelés lenticulaires, nuages de forme très régulière, parfois en pile d'assiettes, anormalement immobiles alors que le vent souffle avec intensité.
C'est en vol d'onde qu'ont été réalisés les plus grands records d'altitude absolue et de distance.
Vol de gradient
Modèle:Article détaillé Quelques pilotes comme Ingo Renner ont utilisé les différences de vitesses entre différentes masses d'air superposées. Cette technique est surtout utilisée par les albatros et les pilotes de modèles réduits radio commandés.
Un pilote débutant « fait le plein » tous les 2 à 8km, si les conditions le permettent. Un pilote confirmé, qui exploite mieux les performances du planeur, peut espacer les reprises d'altitude jusqu'à 25km. Il se contente, lorsqu'il traverse une ascendance mais estime avoir encore assez d'énergie pour poursuivre sa route, de réduire sa vitesse pour profiter au mieux de l'ascendance, sans pour autant s'arrêter et décrire des cercles sur place.